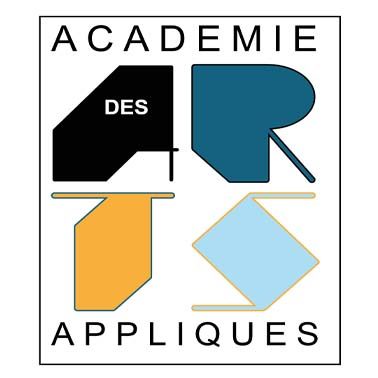Quels que soient le lieu ou la civilisation que l’on explore, des relations profondes entre religion et art se décèlent.
Dans l’art occidental, jusqu’au milieu du XIXe siècle, la religion a été une source inépuisable d’inspiration. Jusqu’à la Renaissance, c’était d’ailleurs quasiment la seule, puis avec la redécouverte de l’Antiquité à cette époque, sont apparues les scènes de la mythologie.
Jusque tardivement, les artistes devaient servir les pouvoirs de l’époque qu’ils soient politiques ou religieux. Avec le romantisme, l’art s’est approprié l’idée selon laquelle il pourrait permettre d’accéder à des connaissances spirituelles supérieures quasi divines. Puis, à partir du 18è siècle et la diversification des mouvements artistiques, les chercheurs considèrent que l’art se concentre sur la célébration de l’homme, en tant que personnage central et non plus des dieux.
Il n’est pas rare que l’art s’efforce de s’émanciper de la tutelle religieuse, or depuis toujours leur symbiose donne lieu religion de l’art.
L’architecture religieuse
Les « maisons des dieux », les temples monumentaux, les sanctuaires et cathédrales… l’architecture religieuse constitue un aspect majeur du lien étroit entre art et religion. L’objectif pratique des structures sacrées est de fournir un lieu de rencontre inspirant pour les fidèles et une demeure pour les prêtres et les moines. Parallèlement, l’architecture religieuse est la plus grande expression de l’effort communautaire, qui va au-delà de ces objectifs pratiques : l’imagination artistique peut s’y exprimer librement. Nous pouvons par exemple souligne l’importance de ces édifices religieux qui s’élèvent vers le ciel, comme une transcription de l’imaginaire collectif d’être au plus près des dieux.
Des pyramides égyptiennes au cercle de pierres de Stonehenge, de la Sainte-Sophie d’Istanbul à la Grande Mosquée omeyyade de Damas, du Dôme du Rocher de Jérusalem aux cathédrales gothiques françaises, de la basilique Saint-Pierre de Rome au Taj Mahal, les autorités religieuses ont toujours eu recours à l’architecture pour impressionner et influencer leurs fidèles. Les décorations artistiques intérieures et extérieures de ces églises chrétiennes, islamiques et bouddhistes comprennent généralement un large éventail d’arts décoratifs, notamment : la calligraphie, la céramique, l’artisanat, les icônes, les manuscrits enluminés, la métallurgie, la mosaïque, les vitraux, la tapisserie et la sculpture sur bois.
Sources des images : Freepik, Pexels

La religion et sa représentation

C’est justement parce que la religion et l’art ont à voir avec des choses similaires – à savoir la représentation de ce qui n’est pas visible – qu’ils s’efforcent souvent de se démarquer mutuellement. La religion peut par exemple se montrer hostile aux images : interdiction, querelle et destruction sont ici trois mots clés.
Les images sont omniprésentes. Pourtant, il y a toujours eu et il y a toujours – surtout dans des contextes religieux – des réserves à leur l’égard, qui vont de la critique réfléchie à la destruction violente d’images et de statues. Du point de vue de l’histoire des religions et de la culture, il faut citer d’une part les fameuses « cultes d’images », telles que nous les connaissons par exemple dans les traditions gréco-romaines, et d’autre part le rejet, que ce soit dans l’interdiction juive, dans la querelle byzantine ou dans la destruction de la Réforme. Même en dehors des traditions judéo-chrétiennes, les images jouent et ont joué un rôle controversé.
Enfin, le débat sur les images et leur fonction s’étend jusqu’à l’actualité politique : la controverse récente sur les caricatures de Mahomet ou la destruction des statues de Bouddha de Bamiyan par les talibans sont autant d’exemples d’une controverse actuelle et historiquement explosive sur les représentations religieuses.